Accueil > GUERRE DE LIBERATION > 2012 : 50ème ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE > 15 MARS 1962 - BEN AKNOUN : ASSASSINAT DE MOULOUD FERRAOUN - OULD-AOUDIA - (...)
15 MARS 1962 - BEN AKNOUN : ASSASSINAT DE MOULOUD FERRAOUN - OULD-AOUDIA - HAMMOUTENE - AYMARD - BASSET - MARCHAND
vendredi 16 mars 2012
15 MARS 1962 : LE MASSACRE DE BEN AKNOUN - algerieinfos - Saoudi Abdelaziz - Vendredi 16 mars 2012
POUR UNE RELECTURE PERPÉTUELLE DE FERAOUN - PAR AREZKI METREF - LE SOIR DES LIVRES - mars 2007
15 MARS 1962 : LE MASSACRE DE BEN AKNOUN (*)
Le 15 mars 1962, six enseignants - Mouloud Feraoun, Ould-Aoudia, Hammoutène, Aymard, Basset, Marchand, -, étaient massacrés par l’OAS.
Ces six Inspecteurs de l’Éducation nationale étaient réunis dans le centre social Château-Royal à Benaknoun. Ils discutaient des mesures en faveurs des enfants les plus en difficulté.
Un commando revêtu de tenues léopard survint, les fit sortir dans la cour et les abattit à coup de mitraillettes.

Le lendemain, l’écrivain pied noir Jules Roy, écrit dans L’Express : « Le bas d’un mur criblé de balles et éclaboussé de sang noir dans la cour d’une villa mauresque sur les collines d’El Biar, c’est tout ce qu’il reste de l’attentat contre les six inspecteurs français et musulmans des centres sociaux condamnés à mort par l’O.A.S.
Six hommes qui consacraient leur vie à sauver des gosses, donner un métier à des misérables et soigner des malades.
Les hommes qui ont tué Mouloud Feraoun ou qui se sont réjouis de sa mort ne peuvent plus être mes frères et je ne les connais plus.
Pourquoi Mouloud Feraoun ? Parce que, ayant reçu le don d’écrire, il avait, lui, un raton, l’audace de l’exercer.
Parce qu’il osait conter son enfance pauvre et son pays, son attachement à ses amis et à sa patrie, et que cette liberté représentait à elle seule un outrage intolérable et une provocation à l’égard des seigneurs de l’O.A.S.
Synthèse blog
Saoudi Abdelaziz
Vendredi 16 mars 2012
(*) Sur le massacre d’El Biar :
- dans le livre de Jean Lacouture « Le témoignage est un combat – une biographie de Germaine Tillon » – Seuil - 2000 - pages 252 - 257
« Le 15 mars 1962, quelques jours avant le cessez-le-feu, l’OAS organise l’assassinat collectif des 6 principaux responsables des Centres Sociaux en réunion à Ben Aknoun, alors que le chef de l’OAS – Raoul Salan- les mitraille de directives criminelles : « Je donne le feu vert pour des actions payantes, » Et, parmi celles-ci, la liquidation des musulmans les plus prestigieux … ».
« De l’horeur que provoque ce massacre, Germaine Tillon se fit, mieux que personne, l’interprète écrivant le surlendemain dans le Monde : La bêtise, la féroce bêtise, a tué, a assassiné, froidement ... Parce que cela entrait dans les calculs imbéciles des singes sanglants qui font la loi à Alger... »
haut de page
POUR UNE RELECTURE PERPÉTUELLE DE FERAOUN
PAR AREZKI METREF
LE SOIR DES LIVRES
mars 2007
Texte de la communication prononcée le 30 mars 2007 à la Maison de la Culture de Tizi-Ouzou
J’interviens ici en tant qu’artisan des mots soucieux, pardonnez- moi, d’ajouter mes mots à ceux de Feraoun pour dire Feraoun.
Soucieux aussi de le lire. Ce que je livre là est une sorte de voyage libre dans et autour de l’œuvre de Mouloud Feraoun, de sa vie, des marges de l’une et de l’autre. Je fais ce voyage dans la discontinuité chronologique, en brouillant à mon corps défendant les repères de lisibilité et en oubliant qu’il faille conclure car, s’agissant de conclusion, il n’y en aura jamais de définitive puisque, et je l’espère, on continuera à lire et relire Feraoun.
Je commence par un aveu. Lorsque les organisateurs de la rencontre m’ont demandé comment je souhaitais intituler cette communication, — ou plutôt cette causerie —, j’ai répondu spontanément, sans coup férir : l’héritage de l’humanisme de Feraoun ! J’avais, en vérité, peu ou pas du tout réfléchi à la lourdeur de la tâche, à la prétention de l’entreprise, et à la multiplicité des conséquences de cet énoncé.
Dont cette conséquence induite en trois temps :
premier temps : sous-entendre qu’au lieu de poursuivre cette pratique de célébrations désincarnées, il faut au contraire visiter ou revisiter les textes ;
deuxième temps : suggérer de cesser ces hommages généraux et interchangeables, ces évocations fugaces le temps d’un anniversaire, et parfois même ces invocations lorsque la paresse de lire conjuguée au culte maraboutique des absents pousse à la sanctification postmortem ;
troisième temps, qui a à voir avec le temps précédent et avec celui d’avant même : endiguer la « commémorite » (action compulsive de commémorer à tout-va !) au profit de la fructification de ces véritables trésors que sont les livres, — trésors précieux à condition de les lire et de les faire lire.

Pour cela, l’écrivain Mouloud Feraoun a besoin de trois choses :
1 : être lu ;
2 : être lu ;
3 : être lu.
Le martyr Mouloud Feraoun, assassiné par les criminels de l’OAS, a besoin, lui aussi, de trois choses :
1 : être lu ;
2 : être lu ;
3 : être lu ;
On pourrait s’en tenir là. Fermer le ban et repartir chacun avec nos ouvrages de Feraoun sous le bras. Mais non, il faut lire et, pourquoi pas, dans le partage, en public, en faisant circuler le sens et les interrogations, en multipliant les échos. Feraoun nous a réunis. Il peut même nous unir. Toujours cet humanisme, au-delà des frictions qui nous font en tant que passé et nous défont d’ores et déjà comme avenir. Lire, et dans la connivence. Il est des moments où le talent du lecteur ravive celui de l’écrivain et lorsque le lecteur est multiple le talent de l’écrivain est forcément symétriquement multiple. Lire Feraoun donc, ici et maintenant.
Relire ce recours non point à la fatalité, mais à une sorte de transcendance de la volonté comprise dans le premier chapitre de Le Fils du pauvre . Il y est écrit ceci :
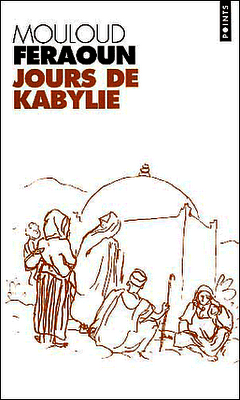
« Nul n’est maître de sa destinée, ô Dieu clément ! S’il est décidé là-haut que l’histoire de Menad Fouroulou sera connue de tous, qui peut enfreindre ta loi ? » Il y a des choses qui échappent à la projection, et même au libre arbitre. Faut-il s’en remettre, et pour de bon, au-delà de la formule, à ce « maître de la destinée » ?
Sa vie durant, en tant qu’homme, et en tant qu’homme emblématique de pressions contradictoires (l’école de Jules Ferry et son humanisme, et ses Lumières et l’école de la misère kabyle et ses lumières sur les raisons de son advenue), en tant qu’être pensant, réfléchissant, se battant, espérant, rêvant, vibrant, est condensée dans ses écrits, dans ces écrits paisibles, souvent empreints de tendresse, doux, où même les conflits opposant les protagonistes les plus inconciliables en arrivent à arrondir les angles et à se dénouer par l’intelligence et l’intelligence du cœur.
Tout l’héritage sensible, intellectuel, esthétique, mental, que l’on peut et doit espérer de lui est dans ses écrits. Il faut le chercher, cet héritage. Il faut le trouver. Il est à la portée de nous tous car il nous est destiné. Il est près de nous et peut-être même en nous.
Par « modestie et par pudeur, Menad Fouroulou, anagramme de Mouloud Feraoun, (Feraoun est le patronyme alloué arbitrairement par l’administration coloniale aux Aït Chavane de Tizi Hibel) scelle son pacte biographique avec un « ami qui ne le trahira pas », — qui n’est pas lui, bien entendu —, choisi parce qu’il « n’ignore rien de son histoire » en sa qualité de « frère curieux et bavard, sans un brin de méchanceté à qui l’on pardonne en souriant ».
Lire et/ou relire aussi cette motivation d’écriture : « Lorsque tout sera dit sur ton compte, Fouroulou, tu auras peut-être cessé de vivre car la vie n’est pas longue, décidément. Tes enfants, les enfants de tes enfants, sauront-ils que tu as souffert ? Oui, il serait bon qu’ils le sachent, mais ils auront à souffrir, eux aussi, à aimer, à lutter. Quelle leçon conviendrait-il de leur donner ? « Une leçon ? Il n’y a pas de leçon », murmures-tu. Je vois ton sourire doux et résigné. Tu veux que le narrateur se taise.
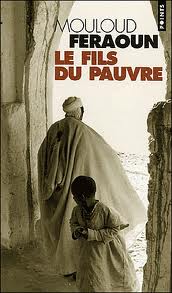 Non, laisse-le faire. Il n’a pas beaucoup d’illusions mais il t’aime bien. Il racontera ta vie qui ressemble à des milliers d’autres vies avec, tout de même, ceci de particulier que tu es ambitieux, Fouroulou, que tu as pu t’élever et que tu serais tenté de mépriser un peu les autres, ceux qui ne l’ont pas pu. Tu aurais tort, Fouroulou, car tu n’es qu’un cas particulier, et la leçon, ce sont ces gens-là qui la donnent. »
Non, laisse-le faire. Il n’a pas beaucoup d’illusions mais il t’aime bien. Il racontera ta vie qui ressemble à des milliers d’autres vies avec, tout de même, ceci de particulier que tu es ambitieux, Fouroulou, que tu as pu t’élever et que tu serais tenté de mépriser un peu les autres, ceux qui ne l’ont pas pu. Tu aurais tort, Fouroulou, car tu n’es qu’un cas particulier, et la leçon, ce sont ces gens-là qui la donnent. »
C’est cela, le génie de Feraoun : brouiller les pistes dans une splendide clarté où on surprend un instituteur qui non seulement se garde de donner des leçons mais accepte d’en recevoir, du fait même de l’existence des siens, des autres, de l’Autre.
Les siens ? Nous, ici, mais aussi partout où le fil d’Ariane de la continuité historique, de la perpétuation des peuples, des cultures, des langues, des traditions en colonnes vertébrales d’une identité en devenir, contraint les hommes à la dualité et même à une certaine ubiquité sociale et identitaire. Dans le même temps, être ici et là, être l’eau et le feu, être l’Eux et le Nous.
Feraoun a incorporé la tolérance, basée sur l’intelligence des partages, dans sa cosmogonie. C’était, comme on dit aujourd’hui, un passeur.
À dater de lui, le chemin entre l’ici et l’ailleurs, entre le dedans et le dehors, est parcouru, le fossé s’est rétréci. La rencontre devient possible autrement que dans le conflit, la domination, l’infériorisation. Elle devient possible en tant que telle, dans un échange où la culture devient la médiation.
Pas un écrivain de sa génération et de sa condition (fils du pauvre ayant accédé à l’instruction et au statut social idoine) n’a concilié aussi harmonieusement l’humanisme des livres et celui, oral, de la transmission traditionnelle kabyle.
Plus tard, lorsque les lois de la guerre sommaient de rompre l’équilibrisme intime, devenu difficilement supportable comme il est décrit dans La cité des roses, cette conciliation est douloureusement vécue.
L’humanisme encore, qui survient dans l’antagonisme ?
L’humanisme de Feraoun, c’est cette culture de la connaissance des siens dans la langue de l’autre, cet entremêlement spontané entre le monde de l’imaginaire kabyle et une pédagogie de la rationalité sociale dans la description de la Kabylie, cet univers dont l’axe de gravitation est l’homme (l’être humain) n’est-il pas ce qu’on appelle aussi « l’universel » ?
Feraoun disait : « J’ai écrit Le Fils du Pauvre pendant les années sombres de la guerre, à la lumière d’une lampe à pétrole. J’y ai mis le meilleur de mon être. Je suis très attaché à ce livre. D’abord je ne mangeais pas tous les jours à ma faim, alors qu’il sortait de ma plume, ensuite parce qu’il m’a permis de prendre conscience de mes moyens. Le succès qu’il a emporté m’a encouragé à écrire d’autres livres (…)
Il faut ajouter ceci : l’idée m’est venue que je pourrai essayer de traduire l’âme kabyle. J’ai toujours habité la Kabylie. Il est bon que l’on sache que les Kabyles sont des hommes comme les autres. Et je crois, voyez-vous, que je suis bien placé pour le dire. Le domaine qui touche l’âme kabyle est très vaste. La difficulté est de l’exprimer le plus fidèlement possible. » L’humanisme est d’évidence universel partout. Et ce n’est pas un hasard si la petite voix des personnages de Feraoun a su murmurer à tant de gens à travers le monde les siècles des siècles de la vie des « rudes montagnards » que nous sommes.
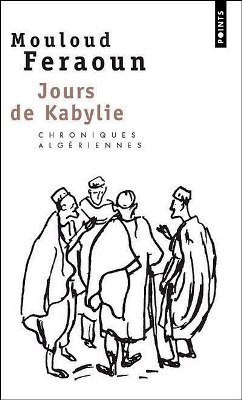
À cet autre niveau, je veux faire remarquer que la force des écrivains est aussi de transmettre des vérités ordinaires en poncifs. En disant des Kabyles « nous sommes de rudes montagnards » , Feraoun a touché juste, tellement juste, que c’en est devenu une expression courante, une sorte de carte d’identité collective que l’on croirait léguée par les ancêtres évoqués, chez lui, non pas comme une galerie de portraits mythiques (comme chez Kateb Yacine) mais dans le visage concret, palpable du père, du grand-père, de ces hommes qui tissent la chaîne qui remonte aux sources premières.
J’entends l’humanisme chez Feraoun dans le sens que lui donnait André Comte-Sponville : « L’homme n’est pas mort : ni comme espèce, ni comme idée, ni comme idéal. Mais il est mortel ; et c’est une raison de plus pour le défendre. » (Présentations de la philosophie)
Cet humanisme pratique et moral, qui parcourt l’œuvre de Feraoun, qui est dans le non-dit autant que dans le formulé, dans le silence que dans le mot, sur les lignes qu’entre elles, c’est celui qui fonde le respect de l’être humain comme un devoir presque naturel et qui dresse ces interdits éthiques qui réprouvent le meurtre, la torture, l’oppression, l’asservissement, le viol, le vol, l’humiliation.
Tout chez Feraoun, la moindre idée, la moindre pulsation poétique, le moindre éclair philosophique dénonce, au nom d’un humanisme qui va de soi, qui est là sans qu’on le remarque forcément comme on ne remarque pas l’oxygène qu’on respire, ces atteintes à la vie et à la dignité de l’homme.
On le voit, déjà à ce niveau, l’héritage humaniste de Feraoun est d’une grande actualité, en ces temps où l’homme ne vaut que ce que lui imputent de valoir les pouvoirs de la force et de l’argent. Jamais celui des idées, et des sentiments !
À la réflexion, j’aurais dû adjoindre le concept d’universalité au primitif humanisme que je voudrais, en tant que lecteur des années 2000, extraire et fructifier de l’œuvre de Mouloud Feraoun.
Le moment venu, on trouvera où se nichent et l’humanisme et l’universalité dans une œuvre qui se présente dans sa déroutante simplicité. Mais attention, derrière le trompe-l’œil de « littérature d’instituteur », deux mots de grande noblesse, Feraoun a planté une œuvre indestructible parce qu’elle plonge ses racines dans nos émois ancestraux en tant que Kabyles universels, et ces émois sont non seulement héréditairement transmis (l’émotionnel est-il, lui aussi, de l’ordre de la culture ; c’est à la littérature de le rendre) mais, en plus, frappés au coin du sens commun, ce qui est le pseudonyme de l’universalité.
Ces qualités littéraires proviennent du fait que Feraoun apparaît, dans ses romans, tout à la fois comme conteur et sociologue, pédagogue, poète. Il faut être tout cela à la fois, sans doute, pour dépeindre l’inédite « âme kabyle ».
J’ai dit, en fait, que le meilleur hommage à rendre à Mouloud Feraoun, voire le seul hommage à mon sens, c’est de lire et/ou de relire son œuvre. Cela peut valoir tous les discours compassionnels, admiratifs, élogieux, hagiographiques que l’on peut tenir et que l’on tient, à saisons fixes, depuis sa disparition brutale et injuste en mars 1962, victime de l’OAS.
 J’ai dit cela et je me suis précipité pour relire, en vue de ce propos, ses trois principaux romans, à laquelle son œuvre n’est bien sûr pas réductible mais qui me semblent être le trépied sur lequel viendra se poser toute littérature qui, dans les temps qui le suivent, temps dans lesquels nous sommes, souhaite pérenniser l’universalité de cette « rugueuse » âme kabyle que Feraoun a su si bien montrer car, quelque part, il l’incarnait.
J’ai dit cela et je me suis précipité pour relire, en vue de ce propos, ses trois principaux romans, à laquelle son œuvre n’est bien sûr pas réductible mais qui me semblent être le trépied sur lequel viendra se poser toute littérature qui, dans les temps qui le suivent, temps dans lesquels nous sommes, souhaite pérenniser l’universalité de cette « rugueuse » âme kabyle que Feraoun a su si bien montrer car, quelque part, il l’incarnait.
Ces trois romans sont, on le devine, Le Fils du pauvre, La terre et le sang et Les chemins qui montent.
Ils font de lui un romancier fondateur, celui qui a élevé au rang de poncif les ruelles tortueuses de Tizi-Hibel, maquillé sous des noms différents, ses places, ses hommes, ses femmes, ses enfants, ses traditions, ses croyances, ses combats, ses espoirs, ses désespérances, ses exils. Avant lui, y avait-il des livres dont les personnages s’appelaient Fouroulou, Menad, Ahmed, Khalti, Titi, Ameur et, dans les cinq cents à mille pages que totalisent cette trilogie romanesque, on peut entrer une grande partie des noms et surnoms courants en Kabylie et qui n’étaient, avant lui, nulle part écrits.
Avant lui, connaissait-on un livre dans lequel la place en dalles de schiste s’appelait tajmaït ?
J’ai retrouvé ce commentaire de Tahar Djaout que je cite avec d’autant plus d’intérêt que nous partageons les mêmes appréciations : « Malgré cette carrière brisée (par la mort), M. Feraoun restera pour les écrivains du Maghreb un aîné attachant et respecté, un de ceux qui ont ouvert à la littérature nord-africaine l’aire internationale où elle ne tardera pas à inscrire ses lettres de noblesse. Durant la guerre implacable qui ensanglanta la terre d’Algérie, M. Feraoun a porté aux yeux du monde, à l’instar de Mammeri, Dib, Kateb et quelques autres, les profondes souffrances et les espoirs tenaces de son peuple. Parce que son témoignage a refusé d’être manichéiste, d’aucuns y ont vu un témoignage hésitant ou timoré. C’est, en réalité, un témoignage profondément humain et humaniste par son poids de sensibilité, de scepticisme et d’honnêteté. C’est pourquoi, cette œuvre généreuse et ironique inaugurée par Le Fils du pauvre demeurera comme une sorte de balise sur la route tortueuse où la littérature maghrébine a arraché peu à peu le droit à la reconnaissance. C’est une œuvre de pionnier qu’on peut désormais relire et questionner. »
Edmond Charlot, l’éditeur algérois qui a promu Camus et Roblès, et Amrouche et Roy, disait de Ferouan, qu’avant lui, la Kabylie — l’Algérie, réalité et parabole — était une terra incognitae dans le portulan littéraire. Charlot : « A l’Ecole normale supérieure, les livres de son condisciple Roblès l’avaient beaucoup impressionné. Il s’est rendu compte que l’on pouvait écrire sur l’Algérie des œuvres où les Algériens n’étaient pas seulement des employés, des « chaouchs », mais avaient une vie à eux, ce qu’on ne trouvait pas dans la littérature coloniale ou pas, appelez comme vous voudrez, qui a existé avant. »
C’est en tout cas pour cette puissance qui a permis à Feraoun de projeter son village — le mien, le nôtre à tous puisque nous sommes désormais dans l’universalité — dans le lieu commun, dans ce que nous avons l’habitude de voir, d’entendre et de lire, que personnellement je tiens l’œuvre de Feraoun pour des fondations vers lesquelles il faut constamment revenir parce que, dans l’errance des mots, il faut des ports d’attache pour se retrouver et se recouvrer, et cette œuvre est un refuge. Et un abri.

Bien sûr que l’attachement à une œuvre et à un écrivain procède d’une succession de « hasards » du parcours personnel de chacun de nous. Ces hasards ne sont jamais tout à fait immanents ; ils sont tels que contrariés par l’existentialisme de Sartre, c’est-à-dire d’une certaine manière choisis.
Comme beaucoup de lecteurs, j’ai rencontré Feraoun par hasard mais ce hasard était déterminé par la confluence d’une double recherche :
- celle d’un enfant en attente d’une représentation de la Kabylie ;
- celle, enfin, d’un lecteur qui cherchait derrière les pages des livres quelque chose qui lui parle.
Les deux étaient chez Feraoun. La Kabylie, matrice esthétique, était pour moi, enfant, comme sans doute pour tous les enfants qui n’y ont pas vécu, une sorte d’Eldorado, qui a servi de berceau à l’enfance de mon père. Cette enfance de mon père ressemblerait à s’y méprendre à celle de Fouroulou. Dans ses exils où il nous a entraînés, mon père parlait de la Kabylie de son enfance juste assez pour susciter et brider, dans le même mouvement, l’imagination. Lorsque j’ai lu Le Fils du pauvre, j’avais l’impression de découvrir tous ces mots que mon père n’a pas prononcés et que ce livre était écrit pour moi — et pour tous les enfants dont la réalité des origines était réduite à flotter dans l’imaginaire.
Ce livre a été écrit pour nous par un certain Mouloud Feraoun mais, de toute évidence, à la demande de mon père et de tous les pères de tous les enfants qui avaient besoin de mots justes pour parachever la figuration d’un imaginaire.
La Kabylie dont le père parlait à demi-mot, qu’il décrivait à moitié, qu’il taisait parfois entièrement, ces personnages graves, pittoresques, libres et entravés, ressemblant à la terre qui les porte et qui sont mes grands-parents, oncles, cousins ; cette Kabylie-là s’est mise soudain à vivre dans les mots de Feraoun.
Pour moi, qui lisais des livres qui me parlaient de gens et des choses qui m’étaient loin dans le temps et l’espace, qui m’étaient loin dans la langue et les valeurs, cette lecture- là a été un tournant à la fois dans mon apprentissage de lecteur et peut-être même dans mon envie d’écrire.
Le Fils du pauvre répondait pour moi aux questions que s’est posées Feraoun lui-même en l’écrivant. Toutes ces questions qui l’ont harassé (comme elles ont harassé Mouloud Mammeri) se résumaient dans cette question fondamentale : notre vie ne méritait-elle pas, elle aussi, d’être racontée ? Feraoun a répondu positivement.
Mais il n’a pas répondu que pour lui-même. Il a répondu pour nous tous, qui ne nous posons plus cette question car précisément il nous a aidés, par ses interrogations littéraires et esthétiques, à ne pas avoir honte de nous, de notre image, de notre place dans le concert de la représentation de l’humanité.
Nos villages, nos traditions, nos femmes et hommes « rudes », notre architecture qui défie les lois de l’ apesanteur, tout cela peut faire un roman, et un beau roman. Personnellement, il m’a fait comprendre que l’universalité n’était pas seulement quelque chose qui nous viendrait des pays dominants, mais une sorte d’édifice commun à tous les hommes, où chacun peut ajouter sa pierre.
J’ai rencontré, dans ma vie de lecteur, des écrivains algériens qui rejetaient chez Feraoun sa « kabylité » assumée en le traitant d’écrivain régionaliste. Ce qui est supposé le singulariser dans un réduit régional opposé à quelque chose qui serait l’universalité se renverse d’un coup lorsqu’on s’aperçoit que les plus grands écrivains de tous les pays et de tous les temps n’ont fait que raconter des histoires qui se sont déroulées dans leur Tizi Hibel respectif.
En faisant un reportage sur les traces de Ferouan à Tiz Hibel il y a deux ans, je me suis aperçu, en effet, à quel point Feraoun a été un écrivain régionaliste comme l’a été, pour sa région, Faulkner ou pour la sienne, Gabriel Garcia Marquez.
Au fond, un écrivain universel est un écrivain régionaliste qui a su universaliser sa région. Et de ce point de vue, Feraoun est indiscutablement un écrivain universel.
Lorsque j’étais au lycée, où j’ai découvert les textes de Feraoun, je le percevais comme un « classique ». Cette image de « classique », tel que la dessinait le programme scolaire, a pris à mes yeux un sacré coup lorsque j’ai lu, au cours de l’adolescence, tour à tour La terre et le sang et Les chemins qui montent.
Pour être différents du Fils du pauvre (narration linéaire), ces deux romans poursuivaient la même démarche d’élévation de la réalité kabyle à un niveau de représentation qui continuait à me sembler réservé — mais de moins en moins — aux autres, notre vie devant rester cantonnée aux échanges oraux dans les familles et, au mieux, dans certains espaces publics confinés. Ces deux romans ont élargi pour moi les possibilités de représentation à deux thèmes « universels » et auxquels un adolescent est particulièrement sensible : l’immigration et l’amour.
J’ai été autant perturbé — dans le bon sens du terme — par la découverte de la vie des immigrés kabyles en France décrite par Feraoun avec son humanisme coutumier, c’est-à-dire toujours en plaçant l’homme au centre de son projet littéraire et esthétique ainsi que par la révélation que la vie des Kabyles était finalement celle de tous les peuples et qu’elle ne se réduisait pas seulement au travail et au respect des traditions. On pouvait aussi ressentir, comme dans les Les chemins qui montent, Ameur pour Dahbia, une vraie passion amoureuse quasi-shakespearienne.
Je voudrais revenir un moment sur l’humanisme : personne n’est assez mauvais pour ne pas être amendable, dans les romans de Feraoun ; tout homme trouve en lui-même les ressources pour être sauvé. Pas de méchant irrécupérable.
L’amour est interdit, prohibé, banni. On n’en parle pas, donc ça n’existe pas. Avec sa douceur et sa lucidité, Feraoun dément cet immense leurre en décrivant les ravages et les emportements du sentiment amoureux. Je voudrais me reporter à ces pages de son roman Les chemins qui montent pour montrer à quel point la liberté qu’arrache l’écrivain Feraoun profite au lecteur et à toute la société kabyle.
« Pourquoi ce sourire navré, ami ? Tu vois, je suis ta femme. Je n’ai plus de secret pour toi. Sur notre amour, Amirouche, je jure de n’être jamais qu’à toi. Viens, tout contre ta femme, caresse-moi. Prends-moi encore, je te le demande. N’est-ce pas que je ne rougis plus devant toi ? Merci, mon chéri. Tu as retrouvé le sourire que j’aime, celui de ta bouche bien dessinée, de tes yeux couleur d’or et francs comme l’or, le sourire de tout ce visage viril et doux à la fois, ce visage d’ange, mon ange. »
Je ne veux pas conclure, je l’ai dit, car conclure, c’est avoir fini de lire.
Or, je plaide pour que nous continuions à lire Feraoun et si une conclusion s’impose, la mienne sera celle-là, banale, humble et provisoire, toute provisoire.
Et s’il le faut vraiment, je le ferais avec cette phrase de Fouroulou parlant de son père : « Il n’y avait rien à répliquer puisque la raison sortait de sa bouche. »

A. M.
Sources Le Soir d’Algérie
le 17 mai 2007
haut de page

