Accueil > TRIBUNES, ACTIVITÉS, LECTURES > COMMENT LES SOVIETIQUES VOYAIENT SADDAM HUSSEIN ?
UN TEMOIGNAGE DE PREMIERE MAIN
COMMENT LES SOVIETIQUES VOYAIENT SADDAM HUSSEIN ?
par Evg. PRIMAKOV : LA RUSSIE ET LES ARABES
samedi 9 janvier 2010
Dans Jeune Afrique du 2 janvier courant, Béchir BEN-YAHMED rend compte d’un ouvrage important de Evgueni Primakov, diplomate soviétique de renommée internationale et parfait connaisseur du Moyen Orien et du monde arabe. Ses témoignages directs sur la personnalité et la politique de Saddam Hussein sont particulièrement saisissants et instructifs, de même que les relations difficiles et complexes de l’URSS puis de la Russie avec les régimes arabes. Socialgerie met aussi en ligne à cette occasion un document d’évaluation très intéressant rédigé en 2007 par Primakov sur la situation, les problèmes et les perspectives de la Russie.
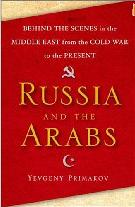
IL Y A TROIS ANS ? ... SADDAM
PRIMAKOV ET LE MOYEN ORIENT
par Béchir BEN YAHMED, le 02 janvier 2010, Jeune Afrique
Evgueni Primakov. Ce nom vous dit quelque chose, mais vous ne savez plus très bien ce qu’il a été, et ignorez ce qu’il est devenu ou même s’il est encore en vie.
Vous êtes excusable, parce que cet homme de 80 ans a quitté la scène depuis plusieurs années : il a, comme on dit, « plus d’hiers que de demains »…
Je vous en parle parce qu’il a publié ses souvenirs et le récit de ses missions au Moyen-Orient, dont l’édition anglaise vient de paraître sous le titre Russia and the Arabs .
Lecture très instructive, comme vous allez le voir.
Evgueni Primakov a été à l’Union soviétique puis, après la disparition de cet empire en 1990, à la Russie ce que Mohamed Hassanein Heykal a été à l’Égypte : d’abord un brillant journaliste très proche du pouvoir, qui l’a chargé de missions secrètes et en a fait son éminence grise, avant d’être nommé ministre.
Mais le Russe a été beaucoup plus loin et plus haut que l’Égyptien puisqu’il a dirigé les services secrets, été ministre des Affaires étrangères et enfin Premier ministre.
C’est un spécialiste du Moyen-Orient, où il a passé de très nombreuses années jusqu’à devenir le meilleur expert russe de la région.
Il a bien connu en particulier Saddam Hussein ; raison pour laquelle, en février-mars 2003, peu de jours avant le déclenchement par George W. Bush de l’invasion de l’Irak, Primakov a été choisi par le président russe Vladimir Poutine pour se rendre à Bagdad et transmettre à Saddam – en tête à tête – « le message de la dernière chance ».
Les communications aériennes avec l’Irak étant alors coupées, Primakov a dû faire la dernière partie du voyage Moscou-Bagdad par la route, à travers l’Iran, et courir les plus grands risques.
Dans son livre, il raconte pour la première fois cette mission qui a fait de lui le dernier dignitaire étranger à avoir parlé longuement avec Saddam, quelques semaines seulement avant sa chute.
Il décrit la psychologie du dictateur irakien et analyse les raisons de son comportement suicidaire. Il le suit, ensuite, de loin, jusqu’à son arrestation par les Américains (dans la nuit du 13 au 14 décembre 2003) et sa fin tragique par pendaison, il y a près de trois ans : le 30 décembre 2006.
Ce qu’il révèle est toujours instructif, parfois passionnant. Je vous en donne à lire de larges extraits qui devraient vous intéresser.
Le Saddam qui s’est révélé à Primakov n’est pas l’homme brutal et primaire qu’il a donné l’impression d’être, mais plutôt, à l’inverse, un homme caméléon, voire un fourbe.
Il a eu, dans les années 1970, sa période anti-impérialiste et prosoviétique. « Avec grand courage, dit Primakov, il a nationalisé l’Iraq Petroleum Company, comme Nasser a nationalisé le canal de Suez. »
L’auteur de Russia and the Arabs précise :
« Il nous a appelés à l’aide, nous puissance communiste, en disant : “Nous n’avons pas besoin d’argent, car l’Irak est riche, mais de votre expertise politique. Aidez-nous à construire un État fort, vendez-nous des armes sophistiquées. Envoyez-nous vos meilleurs cadres, je leur ouvrirai toutes les portes.”
Il l’a fait et a, ainsi, gagné notre confiance ; nous avons envoyé des milliers de conseillers, considéré Saddam comme un vrai partenaire, un leader plein de promesses. Nous avons misé sur lui et fondé sur la coopération avec l’Irak beaucoup d’espoirs.
Mais son entrée en guerre contre l’Iran en 1980 a été pour nous une complète surprise : nous étions ses alliés, et non seulement il ne nous a pas prévenus ni informés, mais il nous avait assuré qu’il n’avait aucune intention de s’engager dans cette voie. »
Primakov poursuit : « Commença alors à notre nez et à notre barbe sa collaboration secrète avec les États-Unis du président Reagan, trop heureux de renforcer celui qui se dévouait pour casser les reins à l’Iran de Khomeiny, qui était alors le grand ennemi des Américains.
Les États-Unis et leurs alliés européens et arabes donnèrent des armes, des informations et de l’argent à l’Irak de Saddam.
Dès ce moment-là, il se crut indispensable aux Américains.
Il se persuadera – et n’en démordra plus – que les États-Unis ne tenteraient jamais rien de grave contre lui, que les pays arabes ne pouvaient rien lui refuser.
Donald Rumsfeld, futur secrétaire d’État américain à la Défense, se rendit à Bagdad en décembre 1983 et déclara que l’Irak et les États-Unis avaient les mêmes ennemis : l’Iran et la Syrie.
L’Amérique renoua des relations diplomatiques avec le pays de Saddam. »
Celui-ci, qui avait, au début de son règne, affiché un certain laïcisme, se convertit progressivement à un islamisme de plus en plus affiché
L’homme caméléon donna l’impression d’entre prendre une nouvelle évolution : il rattacha son arbre généalogique au Prophète, fit à La Mecque un pèlerinage très médiatisé, visita les lieux saints du chiisme irakien, changea le drapeau de l’Irak pour y faire inscrire « Allah Akbar » (« Dieu est le plus grand »).
On le vit jusqu’à sa mort avec un exemplaire du Coran à la main.
Il se peut qu’à l’approche de sa fin il devint réellement pieux : ce qui était posture s’était mué en réalité.
Mais comment expliquer son invasion du Koweït en août 1990 et son attitude suicidaire face à ¬George W. Bush en 2002 et 2003 ?
Là, Primakov conjugue la description et l’analyse :
« À la fin de la guerre contre l’Iran, dont il s’est sorti miraculeusement, Saddam n’était plus le même homme. Il a cru en son étoile et a été comme saisi par une conviction inébranlable qui lui a fait commettre toutes les erreurs qu’il a accumulées à partir de 1990 jusqu’à sa chute en 2003 et même au-delà, jusqu’à sa mort.
Tant qu’il y aura à Téhéran un régime hostile aux États-Unis, ces derniers ne pourront affaiblir l’Irak ou abattre son régime pourvu que ce dernier ne menace pas leurs intérêts vitaux. Qu’ils l’aient fait intentionnellement ou non, de leur côté, les États-Unis ont ancré Saddam dans cette conviction.
Quand il a songé à envahir le Koweït, il ne nous a pas informés, nous ses alliés russes, mais il s’est enquis auprès de l’ambassadrice des États-Unis à Bagdad de ce que serait la réaction de son pays. Lorsqu’elle lui a répondu que Washington considérerait que c’était « une affaire intérieure entre Arabes », cette réponse l’a conforté dans son idée – fausse – que les États-Unis ne prendraient pas le risque de perdre l’Irak comme contrepoids à l’Iran : ils laisseraient faire Saddam. »
Après la description et l’analyse, Primakov passe au témoignage :
« J’ai rencontré Saddam trois fois pendant cette période cruciale de 1990, révèle-t-il. Chaque fois, il m’a dit que les choses allaient s’arranger et tourneraient en sa faveur : selon lui, les États-Unis gesticulaient, parlaient fort, iraient jusqu’à bombarder, mais en aucun cas ils ne s’engageraient dans une guerre terrestre contre l’Irak.
Lorsque Bush père envahit l’Irak mais refusa d’occuper Bagdad et de renverser le régime, Saddam y vit encore une confirmation de son idée principale.
Je souligne, dit encore Primakov, que Saddam, comme d’autres avant lui, croyait en son étoile… Il s’en sortirait toujours, pensait-il, Dieu le protégeait. »
Jusqu’à son arrestation, en décembre 2003, et sa mort, à la fin de 2006, face à Bush fils, Saddam persévérera dans le même aveuglement : le Dieu auquel il donnait l’impression de croire ne lui a pas ouvert les yeux.
Le récit par Primakov de son dernier entretien avec Saddam est saisissant :
« J’ai rencontré Saddam pour la dernière fois à la fin de février 2003, trois semaines avant le déclenchement par les Américains d’une nouvelle guerre contre lui, cette fois pour le renverser.
Le président Poutine m’a chargé de lui porter un dernier message, à lui délivrer personnellement, en tête à tête. S’il suivait sans délai la recommandation qui venait de Moscou, il pouvait encore éviter la guerre : le président Poutine lui conseillait dans le message qu’il m’avait confié de démissionner volontairement de la présidence et de laisser le Parlement appeler à des élections démocratiques pour le remplacer. Pour éviter de créer un vide complet, source d’instabilité, il pourrait conserver la responsabilité du parti Baas.
Je demandai et obtins de le rencontrer seul à seul, en présence seulement de l’interprète qui m’avait accompagné depuis Moscou.
Il m’écouta en prenant des notes puis me demanda si j’acceptais de répéter le message en présence de Tarek Aziz et du président du Parlement, qui étaient dans une pièce voisine. J’acceptai, il les fit entrer et je redis le message en leur présence.
Il se lança alors dans une attaque véhémente contre la Russie, que j’ai réfutée point par point. Il m’écouta, puis me donna une petite tape sur l’épaule, se leva et quitta la pièce.
Avant qu’il ne ferme la porte derrière lui, Tarek Aziz s’exclama, assez fort pour être entendu par Saddam : “Dans dix ans nous verrons qui a raison, notre bien-aimé président ou Primakov…” »
Cette scène surréaliste a eu lieu il y a six ans et Saddam a été pendu il y a déjà trois ans.
En guise de conclusion, Evgueni Primakov écrit : « Après sa chute et même après avoir été arrêté, détenu, jugé et condamné à mort, Saddam a continué à penser que les États-Unis avaient encore besoin de lui, qu’il était le seul leader capable d’organiser le nécessaire contrepoids à l’Iran et au fondamentalisme chiite. »
Jusqu’à son dernier souffle, il a pensé que « l’Iran était l’ennemi des Arabes, de l’islam et des États-Unis », qu’il était capable de faire face seul à cet ennemi et que les Américains devaient comprendre cette dure réalité.
Primakov conclut ce chapitre de son livre en laissant entendre que Saddam, même s’il est mort courageusement, ne s’attendait ni à être condamné à la peine capitale ni à être exécuté.
Il suggère même qu’on l’a jugé, condamné et exécuté à la hâte pour l’empêcher d’en dire plus… Mais Primakov n’est pas historien et ne prétend pas l’être. Il n’a fait que livrer, à nous lecteurs et aux futurs historiens, un témoignage subjectif, certes, mais de première main, et l’analyse d’un connaisseur… J’espère qu’ils vous ont intéressés.
Béchir Ben Yahmed
La Russie rompt avec l’ultra-libéralisme
Evgueni Primakov : la seconde phase du redressement russe a commencé
par Evgueni Primakov*
le 9 FEVRIER 2007
Depuis
Moscou (Russie)
http://www.voltairenet.org/article145230.html#article145230

Evgueni Primakov
Au cours de l’année 2006, la Russie est entrée dans la seconde phase de son redressement, indique l’ancien Premier ministre Evgueni Primakov.
Après s’être attaché à reprendre le contrôle des richesses naturelles et à restaurer la puissance militaire, Vladimir V. Poutine a rompu avec les théories ultra-libérales.
Désormais, l’État s’ingére à nouveau dans l’économie pour organiser le développement du territoire, y compris de la partie asiatique de la Fédération.
Les recettes provenant de l’exportation des hydrocarbures sont injectées dans l’économie intérieure pour lutter contre la pauvreté, sans crainte de relancer l’inflation.
Cependant, cette politique doit faire face à de nouveaux dangers : la montée du chauvinisme à l’intérieur et l’aventurisme militaire états-unien à l’extérieur.
2006, l’année de la fracture
Fracture signifie que les grandes tendances, les tendances déterminantes, sont remplacées par des contre tendances. Il n’est absolument pas obligatoire qu’elles acquièrent immédiatement leur profil intégral, encore moins qu’elles atteignent le point culminant de leur évolution. Si l’on part de cette vision, et c’est mon cas, l’année 2006 aura vu la cassure de toute une série de stéréotypes, imposés à la société russe depuis le début des années 90. Qu’est-ce que je veux dire ?
- Premièrement, après avoir longtemps joué au tir à la corde, nous avons enfin, définitivement j’espère, rejeté l’idée que même à l’aube de l’économie de marché, même avant que soit créé le premier marché civilisé développé, on pourrait se passer d’une ingérence résolue de l’État dans la vie économique du pays. De l’avis des dogmatiques libéraux, le rôle de l’État doit se limiter uniquement à une macrorégulation et l’on n’a nul besoin des investissements de l’État dans le secteur réel de l’économie. _ Citons, comme exemple, la position du ministère des Finances, hostile à la création d’un Fonds d’investissements. En d’autres termes, hostile à un financement ciblé, réalisé sur le budget de l’État, des projets dont le pays a besoin. Seule l’obstination du ministère du Développement économique, qui entra en conflit avec le ministère des Finances, a permis que ce Fonds voit quand même le jour. D’ailleurs, la séparation, en 2006, du « tandem » ministère des Finances - ministère du Développement économique, qui avait précédemment défendu l’idée d’exclure radicalement l’État de l’économie, est devenue un symptôme significatif de fracture.
- Deuxièmement, on a entendu le président Poutine dire, l’an dernier, que, du fait des tarifs mondiaux élevés sur les ressources exportées, les exportations de matières premières devaient servir à développer l’économie et à élever le niveau de vie des Russes. N’est-ce pas le signe de la fracture de la tendance défendue avec zèle par ceux qui déclaraient que le Fonds de stabilisation ne devrait pas dépenser le moindre kopeck à l’intérieur de la Russie car, disaient-ils, cela fera s’envoler l’inflation ? L’inflation, dont les causes sont multiples, résiste également, d’ailleurs, quand on ne touche pas au Fonds de stabilisation. La politique de consolidation effrénée du cours monétaire réel du rouble est elle aussi subordonnée à la lutte contre l’inflation, ce qui nuit gravement à la compétitivité des producteurs russes.
La création de Fonds de ressources non renouvelables est une mesure indispensable comme en témoigne la pratique mondiale. Mais, comment dépenser l’excédent de revenus provenant des prix élevés sur les matières premières exportées ? J’ai lu un article du professeur Alexeï Koudrine dans la revue Questions d’économie. Il présente un tableau intéressant montrant à quelles fins est utilisé l’argent des fonds de ressources non renouvelables au Koweït, en Alaska, au Chili, en Norvège et au Venezuela. Si l’on en croît ce tableau, dans tous ces pays sans exception, l’argent des fonds devient d’une manière ou d’une autre une source de financement de l’économie nationale.
L’exemple de l’Alaska est caractéristique.
Deux fonds y ont été créés : un fonds permanent et un fonds de réserve. La moitié environ de l’argent du fonds permanent est versée à la population de l’Alaska sous forme de dividendes, le reste étant réinvesti.
Quant au fonds de réserve, il sert à créditer le budget. Une limite est fixée à l’utilisation des moyens du Fonds, mais cette limite est mobile, elle peut être revue par le biais de la législation.
Pourquoi l’exemple de l’Alaska est-il aussi important ? Parce que ce territoire connaît également des problèmes de démographie et de développement.
Autre exemple caractéristique, le Fonds pétrolier d’État de la Norvège (ceux qui sont partisans de ne pas toucher aux fonds des ressources non renouvelables aiment se référer à la pratique de ce pays).
Or, toujours selon le tableau cité, l’argent du fonds norvégien « ne peut être utilisé que pour des transferts au budget du gouvernement central ».
Je pense qu’en 2007 on ne verra déjà plus triompher la position de ceux qui affirment l’impossibilité de dépenser les moyens accumulés par le Fonds de stabilisation, même pour créer des infrastructures de transport en Russie, pays dans lequel 50 000 agglomérations ne sont pas reliées aux grandes routes. Ni pour couvrir la partie des revenus budgétaires, dont la baisse est conditionnée par la réduction des impôts sur les produits de haute technologie, l’industrie de transformation et les petites entreprises.
Il y a également eu fracture dans la mesure où les gens sont de plus en plus nombreux à comprendre que l’allègement du poids des impôts sur ces axes contribuera à la modification nécessaire de la structure de l’économie russe, conduira à la poursuite de son essor et, en fin de compte, accroîtra les sommes alimentant le budget.
- Troisièmement, un tournant résolu a été pris, en 2006, vers une économie à option sociale. Je veux parler des quatre projets nationaux avancés par le président Poutine, concernant la santé, l’éducation, la construction de logements et le développement de l’agriculture.
Le caractère résolu de cette initiative est souligné par le fait que, depuis les débuts de la réforme de marché de l’économie russe, les dogmatiques libéraux affirmaient que l’État doit se soucier uniquement des plus faibles, les autres devant résoudre par eux-mêmes leurs problèmes sociaux. Ils rejetaient, au fond, tout investissement de l’État dans l’homme.
- Quatrièmement, c’est en 2006 qu’a été engagée la lutte contre la corruption. Je ne peux pas dire qu’elle ait déjà dépassé le caractère "sélectif". Mais le fait que certains corrupteurs de haut rang aient été éloignés des affaires, le fait que des apparatchiks de rang intermédiaire fassent l’objet de poursuites pénales insuffle de l’espoir. Un espoir que viennent renforcer les déclarations de Vladimir Poutine, comme quoi la rencontre des fonctionnaires de tous niveaux avec le monde des affaires était un mal extrêmement dangereux. Si, en 2007, ces propos sont suivis de mesures fermes, la corruption sera privée de son terreau nourricier en Russie.
Le rôle de l’État dans l’économie ne faiblit pas
Les acquis économiques de 2006 sont indiscutables. Cela fait déjà plusieurs années que l’essor économique se poursuit : près de 7 % du PIB. C’est bien supérieur au niveau moyen mondial. L’essentiel, ici, c’est que cet essor se déroule sans récessions importantes et se maintient sur une longue période. Pour la première fois, l’inflation n’a pas franchi la barre des 10 %. Les réserves d’or et de devises ont atteint un chiffre record. Le niveau de vie de la population a monté. Je pense que tous ces résultats positifs sont liés, pour une bonne part, à la cassure des tendances esquissées dans les années 90.
Mais peut-on considérer, ce faisant, que nous avons atteint une limite à partir de laquelle le rôle de l’État s’aplanirait dans l’économie ? Non. On ne peut pas juger ainsi la situation. En 2006, les succès se sont accompagnés d’une série de disproportions qui exigent que l’État prenne des mesures sérieuses pour les éliminer. Je ne m’arrêterai que sur quelques unes d’entre elles.
- La première. Malgré une dynamique économique positive, on ne voit pas de sortie de la crise démographique. Elle revêt deux dimensions dans notre pays. D’un côté, la diminution de la population en général, de l’autre, le départ assez rapide de gens qui quittent des régions essentielles sur le plan économique : la Sibérie, la Transbaïkalie et l’Extrême-Orient. En 1991, 22 millions de personnes vivaient dans ce qui est aujourd’hui la circonscription fédérale de Sibérie ; elles ne sont plus que 19 millions aujourd’hui. Vers la fin de 2025, selon les prévisions de Rosstat, il ne restera plus, en Sibérie, qu’un petit peu plus de 17,5 millions d’habitants, soit près de 20 % de moins qu’en 1991. La circonscription fédérale de Sibérie représente près du tiers de la surface de la Russie et le problème ne réside pas uniquement dans le fait que ce tiers est peu peuplé. Le peuplement y est très inégal.
Comme le disait, lors de la réunion du Mercury club, le représentant du président Poutine dans cette circonscription, Anatoli Kvachnine, si l’on trace un cercle de 300 km de rayon autour de Novossibirsk, on y trouvera 12 millions d’habitants, sur les 19 qui peuplent aujourd’hui la Sibérie.
La situation démographique est encore plus difficile en Extrême-Orient, où la population a diminué de plus de 16 % en quinze ans.
Pour résoudre le problème démographique, ce qui constitue un objectif national primordial, il faut proposer un plan complexe et systémique pour le développement de ces régions. On pourra me rétorquer qu’un grand nombre de projets de ce type ont déjà été adoptés. Je répondrai qu’aucun d’entre eux n’a revêtu un caractère d’ensemble, multilatéral et systémique. Bien sûr, on se ressent ici du fait que le contrôle n’est pas à la hauteur pour ces projets éparpillés concernant un problème qui est d’une importance vitale pour la Russie, d’une importance économique, géopolitique et qui touche directement aux intérêts de sa sécurité. Peu avant la fin de 2006, le président Poutine a évoqué ce thème devant le Conseil de sécurité. Il a confié des missions. Nous verrons comment elles seront concrétisées en 2007.
- Deuxième disproportion. Le développement de notre économie en 2006 a conduit à une dynamique de consommation plutôt élevée. C’est très bien. Mais l’augmentation de la consommation s’accompagne du maintien d’une faible compétitivité des produits de l’industrie russe. Un tel déséquilibre stimule l’accroissement des importations, dont le rythme est bien supérieur à celui de l’industrie nationale. La part du commerce de gros et de détail dans le PIB a été supérieure à 35 % l’an dernier. Alors que la part de l’industrie dans le PIB a diminué. Il ne s’agit pas, naturellement, de porter moins d’attention au développement du commerce et de la sphère des services, ce qui était un défaut de l’économie durant la période soviétique, ou de mettre des limites aux importations. Il ne faut pas le faire. Mais la question de la compétitivité de la production nationale se pose avec d’autant plus de force. Pour parvenir à une solution, il faut obligatoirement mettre l’industrie sur les rails de l’innovation. Et l’on ne pourra pas se passer, ici, d’une ingérence sérieuse de l’État.
Ces dernières années, c’est un véritable bond qui a été effectué en Russie, avec la création d’un Fonds d’investissements financé par le budget, d’un fonds venture, des zones économiques spéciales, la formation prévue d’une régie publique pour le développement qui sera spécialisée dans le financement des projets d’investissements à long terme, notamment en matière d’exportation. En même temps, et il ne faut pas se fermer les yeux là-dessus, l’utilisation des instruments créés pour les activités d’innovation est de faible amplitude. En Russie, par exemple, on créé quatre zones d’innovation et de développement en tout et pour tout. Disons, à titre de comparaison, qu’elle sont 57 en Chine.
À ce propos, la voie innovante de développement devient pour la Russie absolument indispensable du fait également de ses difficultés démographiques. Celles-ci entraînent une réduction de l’offre de main d’œuvre, situation à laquelle on ne peut remédier que par une intensification du travail, une élévation de sa productivité, ce qui est impossible en dehors du progrès technique et technologique.
- Troisième disproportion. En dépit d’une certaine diminution du nombre des personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté, l’écart entre les 10 % de la population ayant les revenus les plus élevés et les 10 % de la population ayant les revenus les plus bas demeure et même se creuse. Selon les chiffres de Rosstat, les revenus monétaires des citoyens les plus aisés sont en augmentation alors que ceux des plus défavorisés stagnent. Ce sont donc les riches qui bénéficient le plus de la croissance économique. C’est une tendance alarmante. Elle est loin de contribuer à la stabilité sociale en Russie.
En même temps, il convient de noter une autre face du problème que je qualifierais de circonstance aggravante. On sait que, dans les pays développés, la misère est fondamentalement l’apanage des chômeurs, des immigrés, des familles nombreuses mais, chez nous en Russie, 35 % des gens qui touchent moins que le minimum vital ou qui s’en approchent sont des familles de travailleurs avec un ou deux enfants. En Russie, les pauvres sont, dans leur grande masse, des salariés ou des retraités. Il suffit de dire que plus de deux travailleurs sur trois perçoivent un salaire inférieur au minimum vital dans l’agriculture, plus d’un sur deux dans le domaine de la culture et de l’art. Le faible coût de la main d’œuvre créé, en plus de tout autre chose, un manque d’intérêt pour le progrès technique et technologique.
- Une autre disproportion importante provient du fait que, malgré le développement du fédéralisme, nous conservons, au fond, le système financier d’un État unitaire. De plus si, il y a encore quelques années, on pouvait le justifier ou l’expliquer par la volonté de maintenir l’intégrité territoriale du pays, d’utiliser les flux financiers du Centre vers les régions pour consolider l’État unique, cette explication perd son sens depuis que l’on a édifié une verticale du pouvoir avec la nomination des gouverneurs. D’autant plus que, dans tous les États fédératifs, la centralisation politique est renforcée par une autonomie économique accrue des entités de la Fédération. Mais de quelle augmentation de l’autonomie économique de nos régions peut-on parler si la plupart d’entre elles reversent au Centre une grande partie des impôts collectés localement et dépendent-elles mêmes complètement des transferts et des subventions du Centre fédéral. Cette pratique est souvent expliquée par la nécessité de niveler la situation économique et sociale dans l’ensemble du pays. C’est réellement indispensable, mais pas par le biais de méthodes qui ne satisfont ni les entités bénéficiaires ni les entités donatrices.
- Il n’y a pas à dire, les disproportions sont encore nombreuses chez nous. Citons encore :
- le ralentissement des rythmes de croissance des exportations de pétrole et autres matières premières, qui n’est pas compensé par une augmentation des exportations de produits à haute valeur ajoutée ;
- l’absence d’un système de crédits à long terme à des taux acceptables alors qu’il est nécessaire de garantir un essor économique important et stable ;
- la croissance des investissements étrangers qui se limite au secteur relativement étroit des matières premières ;
- le retard considérable de l’un des pays les plus riches en produits énergétiques pour ce qui est de l’efficacité de l’utilisation de l’énergie ;
- l’absence d’un mécanisme qui protège de façon fiable contre une formation des prix monopoliste ;
- un haut potentiel intellectuel qui n’est pas en rapport avec un rendement extrêmement faible ne constituant que 0,5 % de la production high tech et des hautes technologies sur le marché mondial ;
- enfin, les graves lacunes du mécanisme d’adoption des décision, le gouvernement sachant à l’avance que la majorité parlementaire soutiendra automatiquement tous les projets de loi qu’il soumettra à l’examen de la Douma. L’exemple le plus flagrant en est la loi dite de monétarisation des avantages, dont les insuffisances graves ont eu un impact négatif sur 2006 également, surtout concernant l’accès des bénéficiaires aux médicaments.
Le contexte intérieur et international
Quand on tente d’analyser la situation politique à l’intérieur du pays en 2006, le fait que les nationalistes, mus par la xénophobie, relèvent la tête apparaît comme un des phénomènes les plus douloureux. Le patriotisme doit être l’un des traits dominants du citoyen de la Russie. C’est-à-dire l’amour de la Patrie et du peuple. Mais ce qui caractérise les nationalistes, c’est le désir de toiser les autres en soulignant la supériorité de son propre peuple sur les autres. Certains considèrent l’internationalisme qu’on lui oppose comme une formulation communiste, à laquelle devrait succéder le nationalisme dans les conditions du développement de la Russie dans le cadre du marché. Une telle interprétation est tout à fait fausse et néfaste.
Son caractère néfaste peut être encore davantage marqué quand, pour des motifs incontestablement sains – c’est indiscutable – on utilise une terminologie ambiguë comme l’affirmation de la « démocratie souveraine » de la Russie.
Bien sûr, la Russie était et demeure un État souverain, à l’histoire ancienne et riche. Naturellement, les institutions étatiques russes sont originales, de même que la mentalité d’une grande partie de la population, des Russes comme des autres peuples de notre pays. La Russie est en marche vers les valeurs universelles telles que la démocratie mais elle suit ses propres voies qui tiennent compte des traditions, de l’histoire, du caractère pluriethnique de l’État, de sa situation géographique. Comme de nombreux autres pays d’ailleurs, elle n’admet pas les sermons étrangers infondés et abstraits, et admet encore moins qu’on veuille lui imposer un modèle de structuration de la société, de forme d’administration. Mais il est indispensable que tout cela, qui entre dans le concept de souveraineté de l’État, ne serve pas à ceux qui, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, tentent d’éloigner la Russie des processus objectifs en cours : la globalisation, l’internationalisation de l’activité économique, le rapprochement entre les civilisations. Il est indispensable de défendre les intérêts de la Russie et de toute sa population. Mais cela doit se faire sans une confrontation avec d’autres peuples et pays qui serait humiliante, néfaste et dangereuse pour nous.
Parlons maintenant du contexte international dans lequel la Russie se développe aujourd’hui. La fin de la Guerre froide s’est accompagnée d’un recul du système bipolaire et une organisation multipolaire du monde a commencé à être édifiée. La Chine et l’Inde, qui possèdent un potentiel humain colossal, se développent rapidement. Ces deux pays ont, en 2006, devancé les États-Unis si l’on additionne leurs deux PIB. Etant donné que la croissance économique en Chine et en Inde est 2,5 fois supérieure à celle des États-Unis, il paraît évident que ces deux pays sont ceux qui assurent le plus grand apport à l’essor de l’économie mondiale. La part de l’Union européenne dans le PIB mondial a elle aussi dépassé celle des États-Unis en 2006. Le Brésil et l’Argentine se transforment en pays post-industriels. Le processus d’intégration est prometteur en Amérique latine. Il est difficile d’imaginer que la Russie, dont le développement est dynamique, ne devienne pas un centre autonome dans ce monde multipolaire.
Mais il existe des obstacles objectifs au devenir de cette organisation multipolaire du monde. Il s’agit de la politique des États-Unis. Dans les conditions présentes, c’est le pays du monde le plus développé sur le plan économique, le plus fort sur le plan militaire et le plus à la pointe du progrès scientifique et technologique. Dans ce contexte, sous le gouvernement de l’actuelle administration états-unienne, on a vu se renforcer l’influence de ceux qui tentent de préserver les positions hégémoniques des États-Unis durant cette période d’édification d’une organisation multipolaire du monde. Cela a des répercussions négatives sur le processus de neutralisation des menaces auxquelles se heurte l’humanité depuis la fin de la Guerre froide.
J’en citerai trois.
La première, c’est la prolifération des armes nucléaires et autres moyens de destruction massive en dehors des cinq membres officiels du club nucléaire qui ont appris à faire preuve de modération dans les questions relatives à l’emploi de cette arme.
La seconde, c’est le terrorisme international, qui se manifeste sous les traits de l’islamisme bien qu’il n’ait rien à voir avec l’islam en tant que religion.
La troisième, ce sont les conflits régionaux qui gagnent en puissance.
Le danger est d’autant plus grand que ces trois menaces peuvent être cumulées.
La doctrine de l’unilatéralisme a échoué : et après ?
Au temps de la Guerre froide, la stabilité dans l’arène internationale était assurée par la dissuasion mutuelle des deux superpuissances qui dirigeaient les deux camps idéologiques adverses. En d’autres termes, elle reposait sur une confrontation aux limites nettement dessinées.
Maintenant, conjurer les nouvelles menaces ne peut se faire que par les efforts communs et ciblés de tous les grands centres du monde multipolaire en formation. Mais cette vérité, indiscutable semble-t-il, est loin d’être facilement réalisable. Comme l’a montré l’opération en Irak, les États-Unis se sont arrogé le droit exclusif de déterminer quel pays menaçait la sécurité internationale, et de décider eux-mêmes s’il fallait ou non employer la force à son encontre. En même temps, ils ont proclamé leur ferme volonté d’exporter la démocratie dans des pays dont le régime ne leur convient pas.
On peut d’ores et déjà constater l’échec de cette politique. Un constat qu’admettent également de nombreux représentants états-uniens. Même le président Bush a récemment admis, pour la première fois, que les États-Unis n’avaient pas gagné en Irak. Et comment ! À la suite de l’opération états-unienne, ce pays arabe s’est enfoncé dans le chaos. Une guerre civile s’est engagée sur des bases religieuses. Le danger de partition de l’Irak ressort de plus en plus. L’Irak s’est transformé en principale place d’armes d’Al-Qaida.
L’échec de la politique états-unienne en Irak a porté un coup mortel à la doctrine de l’unilatéralisme. C’est ce qu’ont montré les dernières élections au Congrès, qui ont vu le Parti républicain perdre la majorité dans les deux Chambres.
Mais ce coup mortel ne signifie pas encore la fin de cette doctrine, d’autant plus quand on s’ingénie par tous les moyens à lui prolonger la vie. C’est ce dont témoigne la « nouvelle stratégie » proclamée par les États-Unis à l’égard de l’Irak. Elle consiste en fait, pour le président Bush, à avoir décidé, en dépit du Congrès et de l’opinion publique majoritaire, d’envoyer en renfort 22 000 soldats en Irak. Cette décision est tout à la fois nulle et sans perspectives comme si, pour sortir de l’impasse irakienne, il suffisait simplement aux États-Unis d’accroître d’un sixième la présence de leurs troupes d’occupation. Cette décision, cynique de par son caractère, veut ignorer le fait que les soldats états-uniens ayant trouvé la mort en Irak sont déjà supérieurs en nombre aux victimes new-yorkaises des attentats terroristes du 11 septembre 2001, sans même parler des dizaines et des dizaines de milliers de mort irakiens.
Aux États-Unis, le fait est que l’on comprend de plus en plus largement le préjudice causé par le caractère unilatéral des solutions de forces adoptées. Mais cela ne signifie pas que l’administration états-unienne soit prête à entreprendre des actions multilatérales universelles pour contrer les nouvelles menaces qui pèsent sur la sécurité et la stabilité dans le monde. Fait caractéristique, on ne mise pas sur le renforcement et la modernisation du mécanisme international universellement reconnu qu’est l’ONU, mais sur l’extension du bloc militaire de l’OTAN.
Créée au temps de la Guerre froide en qualité d’organisation régionale, l’OTAN étend peu à peu, à l’heure actuelle, son influence de force sur d’autres régions.
Cette organisation a déjà déployé ses forces armées en Afghanistan. Et personne ne sait comment la situation va évoluer. On ne peut ainsi qu’être mis en alerte quand on voit, par exemple, certains médias étudier l’hypothèse d’une intervention armée en Iran et en Syrie, que conduirait l’OTAN à défaut des États-Unis. Naturellement, la distance est grande entre ces discussions et la concrétisation de l’idée. Nombre de membres de l’OTAN ne voudront sans doute pas parcourir le chemin. Mais ne faut-il pas être sur ses gardes quand ont voit que les nouveaux membres de l’OTAN et les pays qui veulent à tout prix intégrer cette alliance sont souvent prêts à payer un prix incroyablement élevé en échange de la bonne disposition des États-uniens à leur égard ?
L’Alliance de l’Atlantique Nord, qui ne cesse d’englober de nouveaux pays, s’est rapprochée de nos frontières. Cela ne peut manquer de nous inquiéter, bien entendu. D’autant plus que l’extension de l’OTAN s’accompagne d’une rhétorique antirusse ainsi que d’une politique offensive des États-Unis dans les ex-républiques soviétiques. Moscou ne peut manquer d’y voir des actes dictés par le mécontentement qu’éprouvent certains milieux occidentaux en voyant que la Russie, qui est en train de retrouver son grand potentiel prometteur, revient à sa position de grande puissance. N’est-ce pas ce que montre la réaction hystérique qu’a provoquée, en Occident, le fait que la Russie entreprenne de façon résolue de vendre ses produits énergétiques aux prix du marché ?
La Russie : une politique extérieure optimale
Dans ces conditions, notre pays mène, dirais-je, une politique extérieure optimale. Contrainte à consolider son potentiel militaire stratégique et tactique, la Russie démontre de toutes les façons possibles sa volonté de devenir une des principales forces pour la stabilisation de la situation internationale. L’année dernière a confirmé les succès de la politique extérieure russe : établissement de relations étroites, parfois même stratégiques, avec de nombreux pays d’Asie, tout particulièrement avec la Chine et l’Inde, volonté inébranlable d’entretenir des liens étroits avec les pays européens, relations de partenariat mutuellement avantageuses avec les États-Unis. L’essentiel étant que le président Poutine a adopté une ligne qui conjugue la défense ferme des intérêts nationaux de la Russie avec la volonté d’éviter toute confrontation avec les autres pays [1].
Il me semble que les politiques occidentaux devraient réfléchir au rôle et à la place de la Russie dans le monde d’aujourd’hui. Non pas d’une Russie fictive dans laquelle la politique intérieure dégénérerait en menace pour ses voisins. Non pas d’une Russie imaginaire qui utiliserait à des fins impériales les livraisons de produits énergétiques dans les autres pays. Mais de la Russie réelle qui n’a pas l’intention de rester dans le sillage de quelque politique que ce soit mais qui, en même temps, concentre ses efforts sur la lutte contre le terrorisme international, contre la prolifération des armes de destruction massive, n’accepte pas le partage du monde en fonction des civilisations et des religions, cherche à employer ses possibilités exceptionnelles pour mettre fin au conflit extrêmement dangereux du Proche-Orient. De la Russie qui mène une politique refroidissant les têtes brûlées à qui l’Irak n’a rien appris et qui sont prêtes à répéter leurs actions de force mortelles contre les régimes qui leur déplaisent.
On peut dire, en conclusion, que l’année 2006 a été dans l’ensemble réussie pour la Russie. Les processus positifs l’ont emporté dans l’économie et la politique. Mais les problèmes en suspens, certaines disproportions sont apparus plus nettement. Il est absolument nécessaire d’y accorder la plus grande attention en ce début d’année 2007, d’autant que l’année sera rendue plus complexe par le contexte électoral.
Evgueni Primakov
Ancien Premier président du KGB, successivement ministre des Affaires étrangères puis Premier ministre, Evgueni Primakov est aujourd’hui académicien et président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de la Fédération de Russie.
Cet article a été rédigé à partir de l’intervention prononcée par M. Evgueni Primakov lors du symposium annuel du Mercury Club, le 12 janvier 2007.
La version originale russe a été revue par l’auteur, puis traduite en français par Ria Novosti et publiée par le Réseau Voltaire.
[1] « Général Gareev : "la Russie sera l’arbitre géopolitique des conflits à venir" » par Viktor Litovkine, Réseau Voltaire, 26 janvier 2007.
