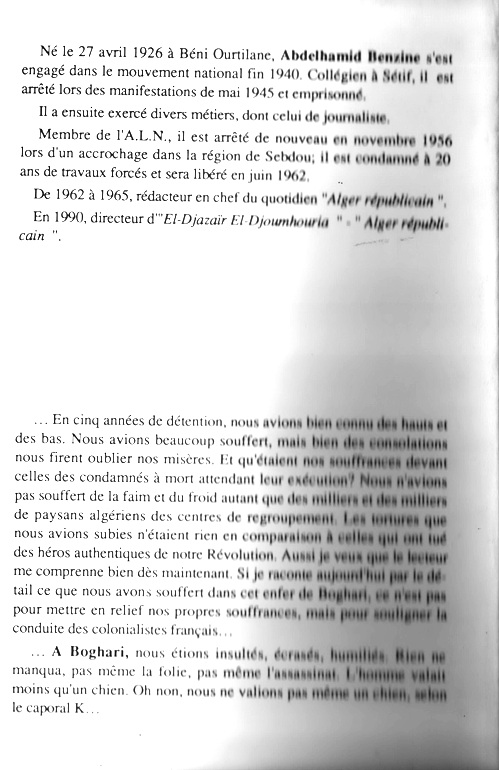Accueil > GUERRE DE LIBERATION > LE CAMP - PRÉFACE DE SADEK HADJERES AU LIVRE DE ABDELHAMID BENZINE, (...)
LE CAMP - PRÉFACE DE SADEK HADJERES AU LIVRE DE ABDELHAMID BENZINE, PUBLIE EN 1961, POUR SA RÉ-ÉDITION EN 1986
mardi 7 mai 2013
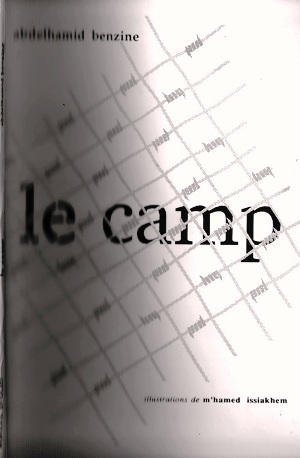
À quelle date nous sont parvenues les premières nouvelles qui nous ont décidés à faire éclater publiquement cette affaire, puis à mettre en projet le projet de faire éditer “Le camp” sans attendre et malgré les risques courus ?
À cette époque, nous ne gardions malheureusement pas beaucoup de traces écrites de notre travail. Mais j’ai fini par retrouver cette date en recoupant plusieurs faits : c’était autour du 6 août 1961.
Comme chaque été, c’étaient les journées les plus brûlantes de l’année, dans l’enfer encore plus brûlant qu’était devenu notre pays depuis près de sept ans.
Le noyau qui assumait la direction du parti sur le sol national après les grandes arrestations de 1957 avait remis sur pied plusieurs activités essentielles et nous en préparions d’autres. Notre cœur portait le poids lourd des camarades innombrables dont la liste augmentait chaque jour : ceux qui avaient péri dans les combats ou sous la torture, les emprisonnés et internés, avec les condamnés à mort dont le sort était en balance chaque matin, ceux enfin dont nous étions restés sans nouvelles. Dure était aussi à supporter aussi la pensée des épreuves inhumaines endurées chaque jour par les familles dans l’océan des souffrances de notre peuple.
Mais dans cette nuit coloniale l’espoir de la libération était à l’horizon, plus clair que le soleil levant. Aussi bien les colonialistes ultra-réactionnaires que de Gaulle et ses « libéraux » ne se faisaient plus d’illusion.
En décembre 1960, notre peuple avait déjà imprimé à la guerre un tournant décisif : son intervention directe, massive, spectaculaire avait pris en grande partie, à sa façon et puissamment, le relais des maquis de l’A.L.N. qui se trouvaient dans une situation très difficile depuis qu’ils avaient été coupés d’une façon quasi étanche de l’A.L.N. des frontières. La « troisième force » que de Gaulle après Soustelle et Lacoste, croyait pou voir faire surgir, faisait une fois de plus faillite. Au plan international également, l’isolement du colonialisme français était chaque jour plus profond. La solidarité de l’humanité progressiste se faisait toujours plus active. Et ces jours-là, chaque passage autour du continent africain du satellite artificiel qui portait Guerman Titov, le deuxième homme de l’espace après l’exploit historique de Gagarine, était pour nous un message d’encouragement. Il rappelait à la planète entière qu’aucune force ne peut faire tourner en arrière la roue de l’Histoire.
Quelques jours auparavant, une nouvelle, si longtemps espérée, m’avait plongé à la fois dans la joie et dans l’angoisse. Au cours de ma rencontre clandestine avec « Bougalb » (le regretté Etienne Neplaz), récemment libéré du bagne de Lambèse mais encore en résidence surveillée, j’appris que Hamid était bien vivant mais qu’il se trouvait à nouveau, en ce moment même, en danger de mort. Je rentrai rapidement vers l’un de mes refuges clandestins le plus proche, bouleversé par les informations de « Bougalb », presque indifférent aux patrouilles militaires et territoriaux français, impatient de lire le message écrit de notre frère, de notre camarade, qu’on venait de me remettre.
Je l’avais vu pour la dernière fois en 1956, de retour des Aurès où il avait été appelé quelques mois auparavant par Chihani Bachir entre-temps « disparu ». ll rapporta de tristes nouvelles de nos camarades montés en été 1955 (Laïd Lamrani et son groupe). Nous apprendrons plus tard que ces patriotes communistes ont été froidement exécutés après la mort de Mostéfa BenboulaÏd par certains nouveaux officiers de l’A.L.N., et notamment l’un d’entre eux qui, par la suite, se ralliera à l’armée d’occupation. Des directives avaient alors été données à Hamid de rejoindre la région de Tlemcen où se posaient quelques problèmes entre les groupes paysans du P.C.A. et les premiers maquis du F.L.N.-A.L.N. Nous nous étions donc rencontrés pour échanger nos dernières consignes et recommandations dans l’obscurité complice et les dialogues bruyants d’une salle de cinéma de Bab-El-Oued.
Son dernier message envoyé du maquis de Sebdou – brûlé plus tard au cours d’une alerte – écrit au stylo bille rouge, nous était parvenu si je ne me trompe pas vers la fin de 1956, dans le même style que les feuillets du “Journal de marche” qu’il écrivait au maquis de Tlemcen-Sebdou, dans les moments de répit que lui laissaient ses déplacements, les réunions ou les combats. Le seul écho que nous ayons eu de lui plus tard était, en une seule fois, l’annonce par les journaux de sa capture et de sa condamnation à vingt ans de travaux forcés par un tribunal militaire français. Ce silence nous inquiétait. Les précautions considérables que nous prenions pour approcher les familles, leurs déménagements fréquents en cette période nous empêchèrent d’en savoir plus, malgré le dévouement inlassable et l’esprit inventif de notre regrettée camarade Djamila Briki, chargée de l’organisation de la solidarité avec les victimes de la répression et qui, en tant qu’épouse de condamné à mort, avait des facilités pour contacter les familles d’autres camarades emprisonnés.
Enfin le silence prenait fin. Hamid était bien vivant. Il avait échappé par miracle à l’exécution sommaire lorsqu’il fut fait prisonnier. Il avait surmonté les mois de tortures et d’isolement cellulaire à Tlemcen et Oran, puis le régime disciplinaire du bagne de Lambèse dont il racontera peut-être un jour comment il participa à organiser, dans l’union avec les patriotes nationalistes, l’action de masse des détenus pour faire reculer et briser la loi de fer que l’administration colonialiste faisait régner.
Contraintes part les luttes de notre peuple de reconnaître son statut de prisonnier de guerre, les autorités coloniales ne le libérèrent de Lambèse que pour le livrer à la racaille bestiale des anciens nazis récupérés par le « Légion étrangère » française et gardiens du camp d’internement spécial de Boghari.
Après plusieurs années de guerre, rien de la barbarie des tortionnaires colonialistes ne nous étonnaient plus. Mais en lisant les lignes hallucinantes écrites par Hamid au péril de sa vie, nous découvrions un peu plus qu’il n’y avait pas de limites à la bassesse de soi-disant « êtres humains » dégradés par l’aveuglement et le mépris raciste. Nous n’avions cependant pas le temps de nous laisser aller à notre angoisse, et il ne nous servait à rien de bouillir dans notre haine de l’occupant. Que pouvait-on faire pour sauver notre camarade et ses compagnons ? Comment éviter que tant de cadres parmi les plus précieux et les plus lucides continuent à être détruits par l’ennemi qui, sentant qu’il avait perdu la partie, s’acharner à vouloir saccager l’avenir de notre peuple ? Et comment faire des agissements odieux des bourreaux l’arme qu’il fallait retourner contre eux et ceux qui les protégeaient ?
Révéler les faits pour mobiliser l’opinion nationale et internationale : c’était certes la voie la plus juste. Le retentissement de La Question, l’ouvrage que notre camarade Henri Alleg avait écrit dans des conditions similaires, l’avait fortement prouvé. Mais comment procéder alors que notre camarade se trouvait entre lesmains de demi-fous féroces dont les réactions imprévisibles pouvaient lui être fatales ?
C’était une décision lourde à prendre et cela tombait mal : notre collectif de direction avait suspendu temporairement certaines de ses liaisons. Il me faudrait absolument joindre Bachir hadj Ali. Ce dernier était littéralement épuisé pas la tension nerveuse due aux alertes quotidiennes dans une ville infestée par l’O.A.S., avec un travail rendu plus harassant encore pas la situation politique qui se compliquait au fur et à mesure que se profilaient les choix du proche avenir avec les pièges et les manœuvres de division néo-colonialistes. Nous avions eu la chance de lui trouver à quelques kilomètres de la capitale une petite « oasis » de relative tranquillité, chez des amis où il pouvait récupérer pendant une dizaine de jours. Il valait mieux aller le voir, le risque en valait la peine. J’avais des papiers pas trop mauvais, mon accompagnateur avait une bonne couverture, et les conbtrôles, nombreux aux entrées de la capitale, ne furent pas trop dangereux.
Nous jugeâmes la situation de notre camarade Hamid d’autant plus sérieuse que les émissions-pirates de l’O.A.S. se multipliaient et que les commandos « deltas » anti-F.L.N. et anticommunistes O.A.S. s’engageaient dans une nouvelle escalade : ils s’attaquaient à des camarades d’origine européenne que le respect de la population, même européenne, avait jusque là protégés et qui refusaient, pour le principe, de déménager malgré les menaces ; pendant notre rencontre même, la radio annonça que notre vieux camarade Duclerc venait d’être poignardé rue du Ruisseau qu’il habitait depuis toujours.
La décision fut prise : diffuser les premières informations dans un tract en direction de l’opinion nationale, et adresser pas l’intermédiaire de nos camarades à l’étranger une lettre à la Croix-Rouge Internationale, en lui demandant d’intervenir pour protéger les internés du camp de Boghari. Le danger ainsi couru était certes grand, mais c’était la seule façon de contrebalancer la menace qui, de toute façon, était très grande, même sans cette initiative.
L’effet de ces deux actions mit les tortionnaires sur la défensive, dans un climat où grandissait le mouvement de l’opinion progressiste mondiale pour la fin de la guerre d’Algérie et où l’opinion française elle-même lassée de la guerre se mobilisait davantage pour sa solution politique. En liaison avec l’action des internés, des améliorations furent apportées à leur sort. Mais rien n’était encore garanti. Il fallait approfondir l’action, pour empêcher que, contraints au recul, les tortionnaires ne se vengent d’une façon ou d’une autre sur Hamid ou l’un de ses compagnons.
L’initiative audacieuse de rédiger Le Camp, dans les conditions que l’auteur décrit, répondit à cette attente. Les précautions pour récupérer le manuscrit furent encore plus grandes, étant donné que les services de répression étaient déjà alertés et exerçaient une surveillance plus étroite. Mais ils ne s’attendaient peut-être pas à un prolongement aussi important de l’action. Inutile de dire l’émotion que suscita parmi nous le manuscrit lorsqu’il nous parvint, parmi les camarades qui le mirent en forme, le tapèrent et le transportèrent. Il fut tiré en France en un temps record. Sa très large diffusion souleva une nouvelle vague d’émotion et d’indignation ; ce fut l’un des facteurs mobilisateurs qui contribuèrent à la protestation géante du peuple et des démocrates français qui s’exprima dans les manifestations telles que celle de Charonne.
Quant à Hamid, atteint d’une artérite sérieuse entraînant un début de gangrène du pied, il fut hospitalisé sous bonne garde à l’Hôpital Mustapha. Nouveau succès, mais nouvelles angoisses. Cet hôpital était pratiquement sous la coupe des activistes ultra-colonialistes, y compris parmi certains médecins qui n’hésitaient pas à refuser des soins corrects aux patriotes ou pire encore, à se faire complices ou acteurs de leur « enlèvement » par les réseaux colonialistes. Le danger était grand. Nous avons alors commencé à préparer son évasion, en utilisant certains appuis que nous eûmes la chance de trouver. Il y eut un premier contact. Le plan avançait lorsque nous apprîmes que Hamid était évacué de l’hôpital sous prétexte que son état s’était amélioré. Hélas, il n’échappait à un danger que pour tomber dans un autre. Durant des mois nous ne sûmes plus où il était. Nos craintes grandirent en ne le voyant pas se manifester après le cessez-le-feu du 19 mars. Les colonialistes l’avaient éloigné pour l’isoler dans un camp militaire à Hammam Bou Hadjar, non loin de la frontière marocaine. Il ne fut libéré que parmi les tout derniers (pris les armes à la main) peu de temps avant la proclamation de l’indépendance. Ce fut l’une de nos joies de cette époque fiévreuse, lorsque nous pûmes enfin serrer contre nous notre camarade affaibli, amaigri. Il venait à peine de passer quelques jours au Hammam Guergour chez ses vieux parents qui auraient voulu le garder plus longtemps auprès d’eux. Nous aurions voulu leur donner, à tous, cette grande joie en ces jours où se mêlaient pour notre peuple l’immense allégresse de la liberté acquise, la douleur des absents, la déception d’une indépendance déchirée pas les luttes intestines et assombrie par le comportement avide et brutal des nouveaux profiteurs.
Ce fut précisément cette situation qui en décida autrement. Et Hamid, qui plus que quiconque aurait eu besoin de souffler, de reprendre des forces, fut comme bien d’autres militants et responsables communistes, immédiatement repris par le tourbillon de la lutte.
Et le revoilà en quelques jours à son nouveau et ex-poste de combat, dans cet Alger Républicain, premier quotidien national de langue française reparu dans notre pays libre, faisant entendre une fois de plus à notre peuple sa propre voix, éclairée et amplifiée par les orientations de démocratie, de justice et de progrès social pour lesquelles pendant sept ans aucun sacrifice ne fut jugé trop cher.
Hamid participa donc aux premiers rangs à cette aventure exaltante mais combien éprouvante du quotidien Alger Républicain qui fit entendre à l’Algérie, au moment où elle en avait le plus fortement besoin, les accents de l’unité d’action, de la conscience anti-impérialiste, de la justice sociale, de la fraternité des travailleurs dans notre pays et dans le monde entier. Il lui fallut attendre encore trois bons mois, la situation du journal s’étant à peu près consolidée (il demeurait le premier journal par le tirage et l’influence dans l’opinion), pour aller à son tour consolider sa propre santé, dans ce grand pays dont le peuple connut lui aussi des souffrances indicibles pour instaurer sur sa terre souveraine le droit incontesté des travailleurs.
*
J’avais pensé arrêter là cette évocation des faits, à propos du livre que l’auteur et ses compagnons de lutte m’ont demandé de préfacer, vingt-cinq ans après sa première édition.
D’autres raisons me poussent à aller plus loin, des raisons puisées dans les vingt-cinq années qui viennent de s’écouler et dans le présent qui continue toutes ces luttes.
Quel sens peut-on donner aujourd’hui, en particulier pour les jeunes générations, à cette lutte pour la liverté et la dignité humaine, que Hamid menait au camp spécial de Boghari lorsqu’il avait trente cinq ans, alors qu’il boucle cette année sa soixantième année ?
Je n’appelle ici ni au culte de la personnalité dont Hamid serait le premier gêné, ni au discours moralisateur du genre « Sachons être fidèles à l’exemple de … », dont l’abus – parfois pour des buts peu clairs – a rendu nos jeunes souvent allergiques à ces formules.
Pour nous, il est tout à fait naturel qu’un jeune Algérien, un patriote, ait fait son devoir, qu’il ait agi selon son ardente conviction patriotique et sa conscience de classe. Mais le quart de siècle d’existence de notre pays indépendant avec ses luttes nous a appris que cela n’est pas si évident pour certains.
Ce combat pour la démocratie et la dignité de l’homme, mené dans le camp, il l’a prolongé dans l’Algérie indépendante. Il a accepté pour cela les dures épreuves d’une nouvelle clandestinité, de 1965 à 1974, non par esprit partisan ou par esprit de rébellion, mais parce que, pour un homme politique non exilé, c’était la seule façon – y compris dans l’esprit constructif – de continuer à pouvoir exprimer ouvertement son point de vue. C’est ainsi qu’il a lutté pour la réforme agraire, pour la nationalisation des hydrocarbures, pour les droits sociaux des travailleurs, pour l’organisation démocratique des étudiants, des jeunes, des syndicats des ouvriers des villes et des campagnes, à une période où tous ces mots d’ordre étaient considérés comme subversifs. Et c’est lorsque ces objectifs ont commencé réellement à avancer dans le pays, qu’avec d’autres camarades il est revenu à une vie plus normale, la tête haute, mais considérablement affaibli par cette nouvelle épreuve.
Son message n’est pas de ceux qui disent aux jeunes : « de notre temps nous faisions comme ceci ou comme cela – prenez exemple et imitez-nous. » Son message dit : nous avons lutté pour créer de nouvelles conditions et vous partez sur des bases meilleures. Soyez encore plus audacieux que nous ne l’avons été. Le monde actuel vous le permet. Mais soyez vigilants, ce monde reste dangereux. Le fascisme que vos aînés ont combattu cherche à renaître, l’impérialisme est assoiffé de revanche, il use de la menace nucléaire, il se proclame gendarme mondial, il veut remettre les peuples à genoux et transformer notre région en un immense camp. Telle est la doctrine du reaganisme et de son complexe militaro-industriel, tel est le sens des agissements du sionisme, du racisme sud-africain s’appuyant sur les faiblesses et les divisions engendrées par les tendances réactionnaires des rois « pétro-dollars » et les dictatures rétrogrades pseudo-islamiques. C’est la revanche sociale qu’appellent les organisations ultra-réactionnaires qui fleurissent en Europe et se réclament de l’héritage du nazisme cherchant à dévoyer une partie de la jeunesse ouest-européenne pour la lancer dans des crimes contre les immigrés des pays en voie de développement. Quand la voix de notre peuple indigné s’est levée contre l’insolente tribune offerte à Bigeard dans notre presse nationale à l’occasion du trentième anniversaire du 1er Novembre 1954, il ne s’agissait ni d’alarmisme ni de démagogie. C’était la claire conscience d’un réel danger, c’était l’affirmation que la sécurité et la paix dans le Bassin méditerranéen passent par la réconciliation et la coopération entre les travailleurs et les peuples de la région, et non par l’absolution et le blanchissement des crimes commis par les forces de l’oppression et de la violence fasciste.
De tout cela, Le Camp témoigne fortement. Il appelle à faire revivre et s’épanouir dans l’indépendance et la paix jalousement défendues cette terre arrosée de la sueur, des larmes et du sang des générations précédentes. Le livre ouvert construit sous le nez des bourreaux par les internés du camp de Boghari ne restera pas un monument de ciment. Il fécondera dans les esprits et les cœurs de la nouvelle génération la volonté et la conscience nécessaires pour aller de l’avant.
Alger, 6 février 1986
Sadeq Hadjerès